Actus Fiscales
– Juin 2025 –

- Unification du délai de déclaration de succession
- Télédéclaration et télépaiement
- Location meublée : confirmation de la possible double imposition
- Exonération de taxe foncière pour les logements sociaux rénovés
- CFE : délais et voies de recours mentionnés dans la notice en ligne sont opposables
- Revenus de location perçus via une SCI
Unification du délai de déclaration de succession : une proposition de loi pour plus de sécurité juridique
Le 24 juin 2025, plusieurs députés ont déposé une proposition de loi visant à unifier les délais de dépôt des déclarations de succession. Le texte entend remédier aux difficultés rencontrées par les familles lors du règlement des successions, en portant à un an le délai de dépôt applicable sur l’ensemble du territoire, y compris en métropole.
1. Le cadre actuel : un délai différencié selon le lieu du décès
L’article 641 du Code général des impôts prévoit actuellement un délai de :
- six mois pour les décès survenus en métropole ;
- un an pour ceux intervenus hors métropole.
Ce régime différencié repose historiquement sur l’hypothèse selon laquelle les successions ouvertes en métropole seraient plus simples à instruire, du fait d’un accès facilité aux informations patrimoniales et successorales. Cette distinction est aujourd’hui largement contestée.
2. Un décalage avec la réalité pratique
Les auteurs de la proposition de loi relèvent de nombreux obstacles rencontrés dans la pratique notariale, rendant souvent impossible le respect du délai de six mois :
- identification complexe des héritiers ou des dispositions testamentaires ;
- enchaînements de décès dans une même famille ;
- conflits entre ayants droit ;
- difficultés d’évaluation de certains actifs (immobilier, titres) ;
- lenteurs des établissements bancaires ou assureurs pour communiquer les informations ;
- manque de liquidités dans la succession pour régler les droits.
Le texte souligne que seules 30 % des déclarations seraient actuellement déposées dans les délais, selon des données locales de la DGFIP.
3. Des pénalités automatiques jugées disproportionnées
Le dépassement du délai entraîne l’application de majorations de 10 % à 40 % selon les cas, ainsi que des intérêts de retard (0,2 % par mois). Ces sanctions s’appliquent même en l’absence de mauvaise foi des héritiers, et alourdissent considérablement le coût de la succession, parfois sans justification. Elles sont à l’origine d’un contentieux fiscal important.
4. Le contenu de la proposition
L’article unique de la proposition de loi prévoit :
- la modification de l’article 641 du CGI pour fixer un délai uniforme d’un an pour le dépôt des déclarations de succession, quel que soit le lieu du décès ;
- l’harmonisation des articles connexes (641 bis, 642, 1728 du CGI) pour aligner les dispositions sur ce nouveau délai.
Le texte ne modifie ni l’assiette ni les modalités de liquidation des droits de succession. Il n’entraîne donc aucune perte de recette, hormis un simple décalage temporel pour les successions concernées.
5. Une mesure de simplification bienvenue
Cette réforme, si elle est adoptée, permettra :
- une plus grande sécurité juridique pour les familles en deuil ;
- une meilleure articulation avec les contraintes pratiques rencontrées par les notaires ;
- un allègement du contentieux fiscal lié aux déclarations tardives.
Elle constitue une mesure de bon sens, à coût budgétaire nul, qui s’inscrit dans le mouvement plus large de simplification du droit fiscal et d’amélioration des relations entre contribuables et administration.
Télédéclaration et télépaiement : l’obligation est abrogée avant son entrée en vigueur
Un décret publié au Journal officiel du 22 juin 2025 est venu abroger l’obligation de télédéclaration et de télépaiement des principaux actes soumis à l’enregistrement, alors même que celle-ci devait entrer en vigueur au 1er juillet 2025.
1. Une obligation initialement prévue par voie réglementaire
L’article 1649 quater B quater du Code général des impôts, créé par la loi de finances pour 2020, habilitait le pouvoir réglementaire à rendre obligatoires la souscription électronique de certaines déclarations d’enregistrement et le paiement dématérialisé des droits correspondants.
Le décret n° 2020‑772 du 24 juin 2020 avait ainsi prévu une entrée en vigueur progressive de cette obligation, au plus tard le 1ᵉʳ juillet 2025, pour les actes suivants :
- déclarations de dons manuels ;
- déclarations de dons familiaux de sommes d’argent ;
- déclarations de cessions de droits sociaux ;
- déclarations de succession ;
- impositions afférentes à ces actes.
2. L’abrogation de l’obligation par le décret du 30 mai 2025
Le décret n° 2025‑561 du 30 mai 2025, publié au Journal officiel le 22 juin, est venu abroger purement et simplement le décret de 2020. En conséquence, l’obligation de télédéclaration et de télépaiement ne s’appliquera pas à compter du 1ᵉʳ juillet 2025.
Aucune nouvelle échéance n’a été fixée à ce jour.
3. Une dématérialisation toujours possible mais facultative
Le service d’enregistrement en ligne, mis en place par l’administration fiscale, reste opérationnel. Il permet actuellement :
- la télédéclaration des dons manuels, dons familiaux et cessions de droits sociaux ;
- le télépaiement des droits correspondants.
À ce jour, les déclarations de succession ne peuvent pas encore être télédéclarées via ce service.
Le recours à ces outils demeure donc facultatif : les déclarations peuvent toujours être déposées au format papier, auprès des services compétents.
Conclusion
Alors que l’administration fiscale poursuit sa stratégie de dématérialisation des procédures, l’abrogation de cette obligation marque un ralentissement du calendrier réglementaire. Pour les contribuables comme pour les professionnels, cette suspension laisse ouverte la possibilité de choisir entre dépôt papier et voie électronique, tout en reportant une réforme qui devait marquer une étape importante dans la modernisation du service de l’enregistrement.
Location meublée : le gouvernement confirme la possible double imposition à la taxe d’habitation et à la CFE
Par une réponse ministérielle publiée le 3 juin 2025, le gouvernement confirme qu’un même bien peut être soumis simultanément à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) et à la cotisation foncière des entreprises (CFE), dans certaines conditions.
1. Une double imposition désormais assumée
La taxe d’habitation a été supprimée pour les résidences principales, mais elle reste applicable aux locaux meublés affectés à un usage autre que l’habitation principale. C’est notamment le cas des logements meublés mis en location saisonnière par leur propriétaire.
Par ailleurs, dès lors que cette activité de location meublée présente un caractère professionnel ou habituel, elle est également susceptible de générer une imposition à la CFE, au titre de l’exploitation d’une activité non salariée.
Le cumul des deux impositions est donc désormais reconnu comme possible : un même bien peut être soumis à la CFE en tant que local professionnel, et à la taxe d’habitation en tant que résidence secondaire meublée.
2. Le critère central : la jouissance du bien
Selon la réponse ministérielle précitée, le critère déterminant est celui de la jouissance du bien par le propriétaire. Le texte indique que :
« Lorsqu’au cours de l’année, des locaux sont mis en location pour de courtes durées et pour des périodes qu’il est loisible au propriétaire d’accepter ou de refuser, ce dernier est regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant en conserver la jouissance ou la disposition. »
Autrement dit, lorsque le propriétaire conserve la faculté de décider des périodes de mise en location, il est présumé conserver la jouissance du bien. Cette présomption justifie l’imposition à la taxe d’habitation, en complément de la CFE.
3. Exonérations possibles mais encadrées
Il existe néanmoins plusieurs cas dans lesquels le loueur en meublé peut bénéficier d’une exonération de CFE :
- Lorsque le local loué est compris dans l’habitation personnelle du loueur (résidence principale ou secondaire),
- Lorsque le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 5 000 euros,
- Lorsque le bien est situé dans une zone classée « France ruralités revitalisation », sous conditions,
- Sur décision des collectivités territoriales compétentes.
Il convient toutefois de noter que ces exonérations n’ont aucun effet sur l’éventuelle application de la taxe d’habitation, laquelle repose sur des critères distincts.
Conclusion
Ce positionnement clair des services de Bercy entérine un principe de double taxation des locations meublées de courte durée, qui appelle à une vigilance particulière de la part des propriétaires. Le montage juridique et fiscal de l’activité, le mode de gestion locative, ainsi que la fréquence des locations doivent être évalués au regard de leurs conséquences fiscales locales, souvent sous-estimées.
Exonération de taxe foncière pour les logements sociaux rénovés : précisions de l’administration
L’article 71 de la loi de finances pour 2024 et le décret n° 2024-1142 du 4 décembre 2024 ont instauré une nouvelle exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), applicable aux logements locatifs sociaux anciens faisant l’objet d’une rénovation lourde visant à améliorer leur performance énergétique et environnementale.
L’administration fiscale a commenté ce dispositif dans une actualité BOFiP du 4 juin 2025.
1. Conditions d’éligibilité
Pour ouvrir droit à cette exonération, plusieurs conditions cumulatives doivent être remplies :
- Le logement doit être achevé et constituer un logement locatif social depuis au moins 40 ans à la date de la demande d’agrément ;
- Il doit présenter un niveau de performance énergétique dégradé avant travaux (classes E, F ou G en métropole, ou critères équivalents en outre-mer) ;
- Il doit atteindre, après travaux, un niveau de performance élevé (classes A ou B en métropole);
- Il doit respecter des critères de sécurité d’usage, de qualité sanitaire et d’accessibilité, sauf impossibilité liée à la configuration ou à la préservation du bâti ;
- Un agrément doit être obtenu, délivré par le représentant de l’État dans le département.
2. Durée de l’exonération
L’exonération s’applique pendant 15 ans à compter de l’année suivant l’achèvement des travaux.
Cette durée est portée à 25 ans si la demande d’agrément est déposée entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026.
3. Portée de l’exonération
Le dispositif concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties ainsi que les taxes additionnelles à cette imposition.
En revanche, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) reste due.
L’exonération ne peut pas être cumulée avec d’autres dispositifs d’allègement de taxe foncière portant sur les mêmes logements, tels que :
- l’exonération de deux ans pour les constructions neuves ;
- les dégrèvements pour travaux d’économie d’énergie ou d’accessibilité.
Elle prend fin en cas de perte des conditions d’éligibilité, notamment en cas :
- de changement d’usage ;
- de perte du caractère social du logement ;
- de remise en cause de l’agrément.
4. Modalités déclaratives
Pour bénéficier de l’exonération, le redevable doit déposer une déclaration d’achèvement des travaux, accompagnée de la décision d’agrément, dans les 90 jours suivant la réalisation des travaux.
Conclusion
Ce nouveau dispositif s’inscrit dans une logique d’incitation à la rénovation énergétique du parc social ancien. Il constitue une opportunité fiscale substantielle pour les bailleurs sociaux engagés dans des projets de réhabilitation lourde, sous réserve d’une anticipation rigoureuse des conditions administratives et techniques requises.
CFE : les délais et voies de recours mentionnés dans la notice en ligne sont opposables
La cour administrative d’appel de Toulouse confirme, dans deux décisions rendues le 20 février 2025 (n° 23TL02819 et 23TL02911), que les mentions relatives aux voies et délais de recours figurant dans la notice jointe à l’avis de CFE en ligne sont valablement notifiées au contribuable et font courir le délai de réclamation.
1. Le contexte : la dématérialisation des avis de CFE
En application de l’article L. 253 du Livre des procédures fiscales, les avis d’imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) issus du rôle primitif sont exclusivement mis à disposition sous format dématérialisé, dans l’espace professionnel en ligne du contribuable.
Dans l’affaire jugée, l’avis d’imposition de CFE ne mentionnait pas directement les voies et délais de recours. Toutefois, l’administration démontrait que cet avis était accompagné d’une notice accessible à partir de la même page, via un onglet dédié, expliquant les modalités de contestation.
2. Une notification régulière au sens du droit administratif
La cour administrative d’appel de Toulouse juge que la simple mise à disposition de la notice, dans les conditions décrites, satisfait aux exigences posées par :
- l’article R. 421-5 du Code de justice administrative (exigeant la mention des voies et délais de recours dans toute décision administrative notifiée) ;
- l’article R. 196-2 du LPF (qui fixe à jusqu’au 31 décembre de l’année suivant la mise en recouvrement le délai pour introduire une réclamation en matière de CFE).
La mention contenue dans la notice en ligne est donc opposable au redevable. En conséquence, une réclamation déposée au-delà du délai est irrecevable.
3. Une jurisprudence désormais cohérente entre format papier et dématérialisé
Cette solution s’inscrit dans le prolongement de décisions antérieures ayant déjà admis, pour un avis papier, que les voies de recours mentionnées dans une notice jointe suffisaient à faire courir le délai de contestation (TA Amiens, 26 janv. 2023, n° 2004144 ; CE (non admis), 9 nov. 2023, n° 472515).
La cour administrative d’appel de Nantes a également rendu une décision convergente le 18 février 2025 (n° 24NT00200), bien que moins explicite.
4. Portée pratique pour les redevables
Cette décision rappelle l’importance, pour les entreprises, de consulter avec attention l’intégralité des éléments mis à disposition dans leur espace professionnel, y compris les notices annexes.
Conclusion
Les mentions relatives aux voies et délais de recours ne doivent pas nécessairement figurer dans l’avis principal de CFE pour être opposables. Leur présence dans une notice accessible en ligne suffit à faire courir le délai de réclamation. Une vigilance accrue est donc requise lors de la consultation des avis fiscaux dématérialisés pour éviter tout risque d’irrecevabilité.
Revenus de location perçus via une SCI : pas d’impôt sur les sociétés pour les organismes sans but lucratif
Dans un rescrit du 21 mai 2025 (BOI-RES-IS-000110), l’administration fiscale confirme qu’un organisme sans but lucratif (OSBL) membre d’une SCI non soumise à l’IS n’est pas passible de l’impôt sur les sociétés à raison des revenus fonciers qui lui sont attribués, sous certaines conditions.
1. Le contexte : des OSBL associés de SCI
Les organismes sans but lucratif, bien que normalement exonérés d’impôt sur les sociétés (IS) au titre de leurs activités non lucratives, peuvent percevoir des revenus patrimoniaux, notamment lorsqu’ils sont associés dans des sociétés civiles immobilières (SCI) non translucides.
La question se pose alors du régime d’imposition applicable à la fraction de revenus de location (immeubles bâtis ou non bâtis) perçue par l’OSBL via la SCI.
2. La solution retenue par l’administration
L’administration indique que ces revenus ne sont pas imposables à l’IS, dès lors que :
- la SCI relève du régime des sociétés de personnes (et n’est donc pas elle-même passible de l’IS),
- l’OSBL est membre de cette SCI sans participer à une activité lucrative au sens fiscal,
- et la SCI n’est pas une société immobilière de copropriété mentionnée à l’article 1655 ter du CGI.
Cette solution s’appuie sur la combinaison des articles :
- 206, 5 du CGI, qui énumère limitativement les cas où les revenus patrimoniaux des OSBL sont soumis à l’IS,
- et 218 bis du CGI, qui précise que les associés de sociétés de personnes ne sont personnellement soumis à l’IS que lorsqu’ils sont eux-mêmes passibles de cet impôt – ce qui n’est pas le cas des OSBL.
L’administration confirme ainsi que, sauf disposition expresse, les OSBL restent exonérés de l’IS sur leur quote-part de revenus fonciers issus de sociétés civiles immobilières transparentes, à l’exception des SCI visées à l’article 1655 ter.
3. Une confirmation utile, mais sans nouveauté doctrinale
Cette position reprend, de manière plus explicite, celle déjà formulée dans une réponse ministérielle ancienne (Rép. Beauguitte, AN, 1er juillet 1975, n° 18984), mais jamais intégrée à la base BOFiP jusqu’alors.
Elle clarifie une situation dans laquelle certains OSBL pouvaient s’interroger sur la nécessité de déclarer des revenus fonciers perçus par l’intermédiaire d’une SCI, par crainte d’un assujettissement automatique à l’IS.
Conclusion
Un organisme sans but lucratif associé d’une SCI non soumise à l’IS n’est pas imposable à l’impôt sur les sociétés au titre des revenus de location qui lui sont attribués, sous réserve du respect des critères posés. Cette précision, bien que conforme à l’économie générale du droit fiscal applicable aux OSBL, vient sécuriser une pratique répandue dans le secteur associatif ou institutionnel.
Pour toute question, notre équipe reste à votre disposition.
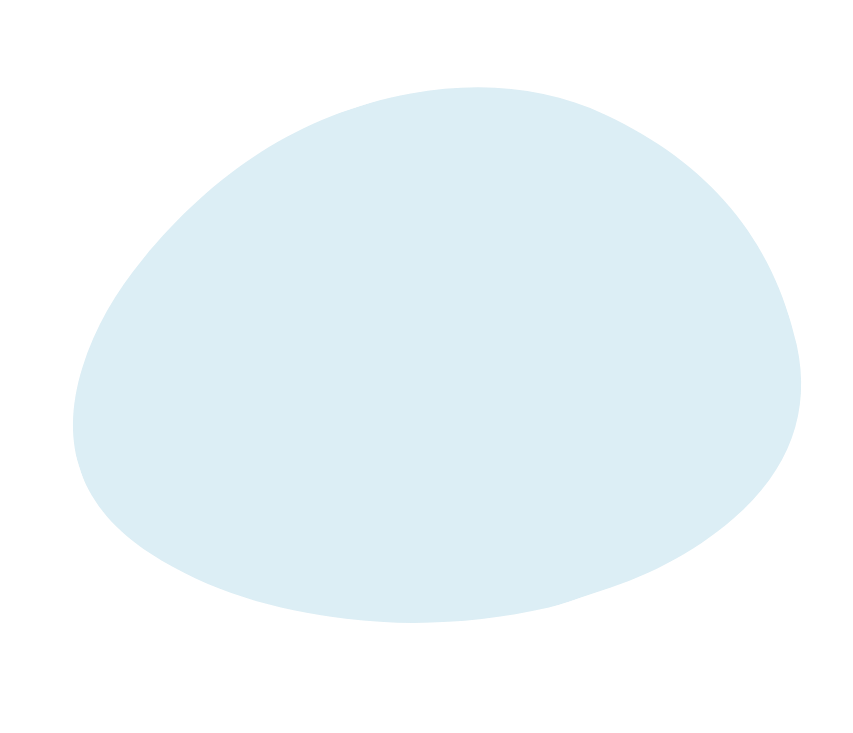
En découvrir plus avec nos articles similaires :

Actualités sociales – Décembre 2025
Plafond de la sécurité sociale, hausse du SMIC, nouvelles règles de contrôle Urssaf, négociation sur l’emploi des seniors et décision récente en matière de maladie professionnelle : faites le point en quelques minutes sur les principales actualités sociales de décembre 2025 et leur impact pour votre entreprise.

Infos clés du mois en droit social – Novembre 2025
Le PLFSS 2026 bouleverse la sécurité sociale : suppression de certains avantages pour les apprentis, durcissement des arrêts maladie, réformes des pensions et création d’un congé de naissance indemnisé. Découvrez notre analyse complète pour comprendre les impacts pour votre entreprise et vos salariés.
