Actus Fiscales
– Octobre 2025 –

- TVA et offres composites
- Taux de TVA sur les services de collecte et traitement des déchets
- Remboursement de crédit de TVA et cessation d’activité récente
- Holding et taxe sur les salaires
- L’erreur matérielle dans la signification d’un jugement fiscal au ministre : un rappel à l’ordre des principes de droit
- Comptes courants d’associé : taux maximal d’intérêts déductibles
- Valeur locative des locaux professionnels : la rétroactivité du « planchonnement » en question
TVA et offres composites : Bercy confirme la règle du taux unique
La gestion de la TVA sur les offres composites, par exemple un abonnement Internet incluant télévision et presse, a longtemps été source d’incertitudes. Jusqu’en 2021, le droit français permettait de ventiler le prix global pour appliquer à chaque composant son propre taux de TVA. Cette pratique ouvrait la voie à des optimisations (ex. intégration artificielle de services de presse à 2,1 % dans des forfaits télécoms) et plaçait les entreprises sous la menace de redressements en cas de ventilation jugée « irréaliste ».
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dans plusieurs arrêts (Batová 2016, Stadion Amsterdam 2018), avait posé un principe clair : une offre perçue par le consommateur comme indivisible constitue une prestation unique soumise à un taux unique, en pratique le plus élevé parmi les éléments de l’offre.
L’article 44 de la loi de finances pour 2021 a mis le droit français en conformité avec cette jurisprudence. La règle générale est désormais l’application du taux de TVA le plus élevé pour toute offre composite formant une prestation unique.
Deux exceptions subsistent :
- le régime spécifique des agences de voyages, déjà encadré par la directive européenne ;
- une dérogation pour les offres dont l’élément principal relève du taux super-réduit de 2,1 %, en vertu d’une clause de gel européenne.
Le BOFiP du 3 septembre 2025 vient confirmer cette lecture et met explicitement fin à la ventilation hors de ces cas dérogatoires.
Quels impacts pour les entreprises ?
- Hausse potentielle du coût de TVA : les offres composites sont soumises au taux unique le plus élevé ;
- Risques accrus de contrôle en cas de ventilation non conforme ;
- Nécessité de revoir les offres commerciales et la documentation contractuelle pour sécuriser la facturation.
Recommandation Onelaw : identifiez vos offres composites, analysez leur qualification fiscale (prestation unique ou non), et anticipez les impacts financiers liés à l’application du taux le plus élevé.
Taux de TVA sur les services de collecte et traitement des déchets : éclaircissements de l’administration fiscale
L’administration fiscale a récemment apporté des précisions tant attendues sur les taux de TVA applicables aux services de gestion des déchets des ménages et assimilés (DMA). Ces clarifications, publiées au Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts (BOFIP) le 17 septembre 2025, viennent éclairer les zones d’ombre concernant l’application des taux réduits de TVA à ces prestations.
Deux taux réduits applicables
Les prestations de services liées à la collecte et au traitement des DMA peuvent désormais bénéficier de deux taux réduits de TVA. Le taux de 5,5% s’applique aux opérations de tri, de valorisation matière, de collecte séparée et en déchetterie, ainsi qu’aux services concourant directement à ces opérations. Le taux de 10%, quant à lui, concerne les autres prestations de collecte et de traitement des DMA, y compris les services accessoires tels que le transport, le transit, le stockage des résidus ou l’entretien du matériel, à condition qu’ils représentent une part minime du coût total.
La règle des 50% : un critère décisif
L’administration a également précisé les modalités d’évaluation des fournitures ou pièces détachées utilisées dans le cadre de ces prestations. Si leur valeur n’excède pas 50% du coût total de la prestation, elles sont soumises au même taux réduit que le service principal. En revanche, si ce seuil est dépassé, ces éléments sont considérés comme une livraison de biens distincte, soumise au taux normal de 20%. La prestation de services restante bénéficie, quant à elle, du taux réduit qui lui est applicable. Ces précisions sont essentielles pour les professionnels du secteur, qui doivent désormais veiller à une ventilation rigoureuse des taux de TVA dans leurs facturations.
Remboursement de crédit de TVA et cessation d’activité récente : délais et formalisme applicables en cas de perte de la qualité de redevable
Une décision récente du Tribunal Administratif d’Orléans (TA Orléans, 19 septembre 2025, n°2302188) rappelle les règles procédurales encadrant les demandes de remboursement de crédit de TVA pour les entreprises ayant cessé leur activité.
Bien que classique sur le fond, cette décision met en lumière deux éléments importants : la détermination du point de départ du délai de réclamation et la distinction entre une simple demande d’information et une réclamation contentieuse en bonne et due forme.
Le cadre légal
L’article 271 du Code Général des Impôts (CGI) prévoit que la taxe déductible dont l’imputation n’a pu être opérée peut faire l’objet d’un remboursement selon des modalités fixées par décret. Les articles 242-0 A et suivants de l’annexe II au CGI précisent ces modalités, notamment les délais de dépôt des demandes. La situation particulière de cessation d’activité bénéficie d’un régime dérogatoire prévu à l’article 242-0 G de l’annexe II au CGI, qui permet le remboursement du crédit total lorsqu’un redevable perd cette qualité. Cette disposition s’articule avec l’article R. 196-1 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) qui fixe le délai de réclamation au 31 décembre de la deuxième année suivant la réalisation de l’événement qui motive la réclamation, soit en l’espèce la cessation d’activité.
Les faits d’espèce
L’EURL T, entreprise de nettoyage, a cessé son activité opérationnelle le 31 décembre 2019, puis a quitté son local professionnel le 31 mars 2020 après avoir vendu son matériel. Malgré cette cessation, elle a continué à déposer des déclarations trimestrielles de TVA jusqu’au troisième trimestre 2022. Après avoir initialement déclaré un crédit reportable, l’entreprise a demandé son remboursement en avril 2023, demande rejetée par l’administration pour tardiveté.
Le tribunal a rejeté la demande de l’EURL T. Il a rappelé que le délai de réclamation court à partir du moment où l’assujetti n’est plus en mesure de réaliser aucune opération donnant lieu à collecte de TVA. En l’espèce, le tribunal a retenu la date du 31 mars 2020, date à laquelle la société a vendu son matériel et quitté son local, comme point de départ du délai. Par ailleurs, le tribunal a considéré que le courrier du 13 juin 2022, dans lequel l’EURL T demandait à l’administration de lui indiquer comment obtenir le remboursement, ne constituait pas une demande de remboursement formelle, mais une simple demande d’information. La demande formelle de remboursement, déposée en avril 2023, était donc tardive.
Cette décision rappelle l’importance de respecter les délais et les formalismes en matière de demande de remboursement de crédit de TVA en cas de cessation d’activité.
Il est crucial de :
- Identifier correctement la date de cessation d’activité : celle-ci ne correspond pas nécessairement à la cessation administrative, mais au moment où l’entreprise n’est plus en mesure de réaliser des opérations taxables.
- Respecter le délai de réclamation : la demande doit être présentée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation de l’événement motivant la réclamation.
- Formuler une demande claire et non équivoque : une simple demande d’information ne constitue pas une réclamation valable. La demande doit être une démarche positive sollicitant formellement la restitution d’une somme chiffrée.
Holding et taxe sur les salaires : la charge de la preuve de l’absence de fonctions financières du dirigeant
Dans un arrêt récent, la Cour administrative d’appel de Toulouse rappelle une règle essentielle en matière de taxe sur les salaires pour les sociétés holding exerçant une activité mixte. La sectorisation de la rémunération d’un dirigeant, bien que théoriquement possible, ne peut être acceptée par l’administration fiscale qu’à la condition de renverser la présomption de transversalité de ses fonctions par une preuve formelle et certaine.Cadre juridique et présomption de transversalité
L’article 231 du Code général des impôts (CGI) dispose que les employeurs non assujettis à la TVA sur la totalité de leur chiffre d’affaires sont redevables de la taxe sur les salaires. Pour les assujettis partiels, comme les sociétés holding, l’assiette de la taxe est déterminée par un rapport entre les recettes non taxées et les recettes totales, appelé « rapport d’assujettissement ». Les rémunérations des dirigeants, considérées comme des frais généraux, entrent dans l’assiette de la taxe sur les salaires au prorata de ce rapport. Cependant, la jurisprudence admet qu’une société puisse démontrer qu’un salarié, y compris un dirigeant, est exclusivement affecté à un secteur d’activité soumis à la TVA, échappant ainsi à la taxe sur les salaires. Pour les mandataires sociaux, tels que le président ou le directeur général d’une SAS, la démonstration est complexe. L’article L. 227-6 du Code de commerce leur confère en effet « les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société », créant une forte présomption de transversalité de leurs fonctions.Rappel des faits et décision de la Cour
En l’espèce, la SAS G, une société holding, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des années 2015 à 2020. L’administration fiscale a réintégré dans l’assiette de sa taxe sur les salaires la rémunération versée à sa directrice générale (DG), Mme A, considérant qu’elle intervenait dans la gestion de l’activité financière non soumise à la TVA. La société a contesté ces rappels devant le Tribunal administratif de Montpellier, puis en appel devant la Cour administrative d’appel de Toulouse. La société se prévalait d’une décision de son président, en date du 30 septembre 2009, retirant à la DG toute prérogative dans le secteur financier. Cependant, la Cour a rejeté l’appel de la société, rappelant que la DG est présumée, en vertu de sa fonction et des dispositions du Code de commerce, détenir des attributions transversales. Il appartient donc à la société de combattre cette présomption en établissant l’absence totale d’attribution de sa dirigeante dans le secteur financier. La Cour a également souligné que la décision du président n’avait fait l’objet d’aucune formalité de publicité, contrairement au procès-verbal de nomination de la DG, qui conférait à cette dernière des pouvoirs de direction identiques à ceux du président, sans aucune restriction. Cet arrêt rappelle l’importance de la charge de la preuve en matière de taxe sur les salaires pour les sociétés holding. Pour écarter la présomption de transversalité des fonctions d’un dirigeant, il est essentiel de fournir des preuves formelles et certaines, telles que des actes publics et officiels dûment publiés.L’erreur matérielle dans la signification d’un jugement fiscal au ministre : un rappel à l’ordre des principes de droit
Dans un arrêt récent du 25 septembre 2025 (N°24LY00744), la Cour Administrative d’Appel (CAA) de Lyon rappelle des principes essentiels en matière de contentieux fiscal, notamment concernant les délais d’appel et la validité des actes de signification.
Le contexte juridique
En matière fiscale, les délais d’appel obéissent à des règles spécifiques. L’article R. 811-2 du Code de Justice Administrative (CJA) fixe un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Toutefois, l’article R. 200-18 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) institue un régime dérogatoire pour le ministre chargé du budget, qui dispose d’un délai de quatre mois en l’absence de signification directe.
La Cour rappelle que le contribuable peut écourter ce délai privilégié de quatre mois en signifiant directement le jugement au ministre. Dans ce cas, le délai d’appel est ramené à deux mois, conformément à l’article R. 811-2 du CJA.
Les faits et la procédure
Dans cette affaire, la SAS MCB Invest a fait l’objet d’une vérification de comptabilité aboutissant à une réintégration fiscale contestée devant le Tribunal Administratif (TA) de Grenoble. Ce dernier a donné raison au contribuable.
Le jugement a été notifié au directeur du contrôle fiscal le 21 décembre 2023, et le ministre a fait appel. Entre-temps, la SAS MCB Invest a été placée en procédure collective. Le mandataire liquidateur a fait signifier le jugement au ministre par acte du 12 janvier 2024, avec une erreur matérielle : l’indication erronée de la juridiction compétente (la cour d’appel administrative « sise à Grenoble » au lieu de Lyon). Une seconde signification correcte a été effectuée le 24 janvier 2024.
La CAA de Lyon a rejeté la requête du ministre. Elle a jugé que l’erreur matérielle dans la première signification n’avait pas induit le ministre en erreur sur ses droits ni influencé son appréciation quant à l’opportunité de contester le jugement. Ainsi, la signification du 12 janvier 2024 était valable et a fait courir le délai de recours de deux mois. L’appel du ministre, enregistré le 20 mars 2024, était donc tardif.
Cet arrêt rappelle que les erreurs matérielles, pour vicier une signification, doivent avoir une incidence sur les droits du destinataire ou son appréciation des faits. Il confirme également l’efficacité de la stratégie consistant à signifier directement un jugement au ministre pour écourter son délai d’appel.
Comptes courants d’associé : taux maximal d’intérêts déductibles
Le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée supérieure à deux ans s’élève à 4,36 % pour le troisième trimestre 2025 (Avis ECOZ2526684V du 26-9-2025).
Les intérêts servis aux associés sont déductibles des résultats imposables, dans la limite de ce taux moyen. Pour le troisième trimestre 2025, ce taux est donc de 4,36 %.
Les entreprises clôturant leur exercice entre le 30 septembre et le 30 décembre 2025 peuvent dès à présent connaître leur taux maximal de déduction.
Taux maximaux applicables
- 4,81 % pour les exercices clos du 30 septembre au 30 octobre 2025
- 4,73 % pour les exercices clos du 31 octobre au 29 novembre 2025
- 4,64 % pour les exercices clos du 30 novembre au 30 décembre 2025
À noter : Les entreprises clôturant leur exercice en cours de trimestre peuvent opter pour le taux du trimestre en cours si celui-ci est plus avantageux. Par exemple, celles ayant clos leur exercice entre le 31 juillet et le 29 septembre 2025 n’ont pas intérêt à utiliser le taux du troisième trimestre 2025 (4,36 %), inférieur à celui du trimestre précédent (4,60 %).
Valeur locative des locaux professionnels : la rétroactivité du « planchonnement » en question
Le Conseil constitutionnel sera prochainement amené à se prononcer sur une question sensible : la rétroactivité des règles de calcul du « planchonnement » des valeurs locatives des locaux professionnels (QPC n° 2025-1174). Depuis 2017, le « planchonnement » (article 1518 A quinquies du CGI) vise à limiter les effets de la révision des valeurs locatives professionnelles. Concrètement, il atténue les variations trop brutales en majorant ou en minorant la valeur locative de 50 % de l’écart constaté entre l’ancienne valeur et la valeur locative révisée au 1ᵉʳ janvier 2017. Une incertitude est toutefois apparue sur la valeur locative à retenir pour ce calcul : fallait-il utiliser la valeur révisée, 2017, figée, ou la valeur actualisée chaque année ? Le Conseil d’État avait tranché en novembre 2023 en retenant la valeur révisée de 2017. La loi de finances pour 2025 est venue réagir :- pour l’avenir, elle fige expressément la valeur locative révisée de 2017 comme référence ;
- mais, pour le passé, elle valide rétroactivement les impositions 2023 et 2024 calculées selon la position de l’administration (valeur actualisée chaque année), sauf réclamations déposées avant le 10 octobre 2024
Pour toute question, notre équipe reste à votre disposition.
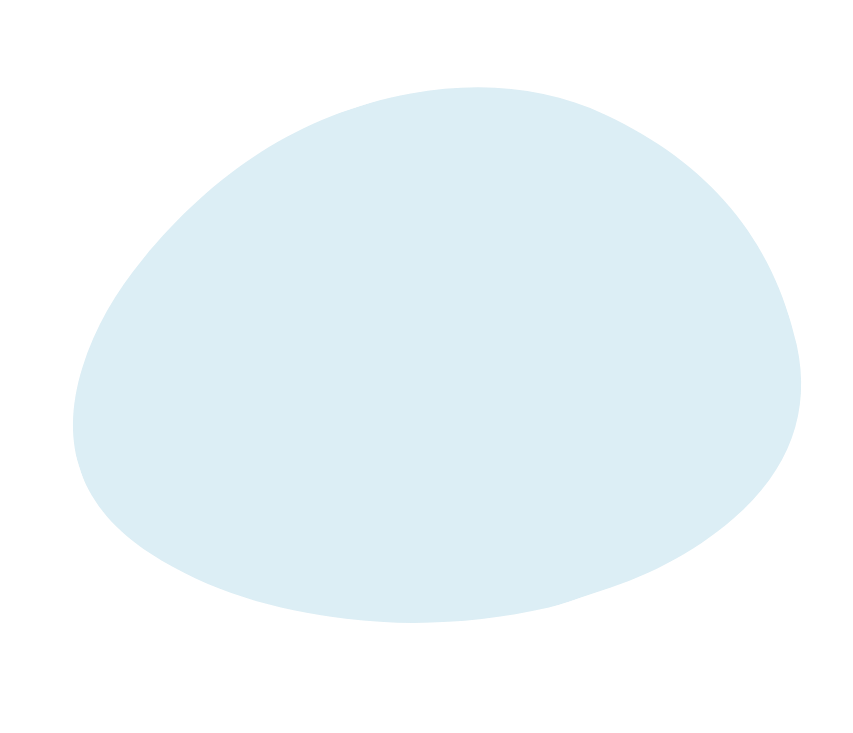
En découvrir plus avec nos articles similaires :

Actualités sociales – Décembre 2025
Plafond de la sécurité sociale, hausse du SMIC, nouvelles règles de contrôle Urssaf, négociation sur l’emploi des seniors et décision récente en matière de maladie professionnelle : faites le point en quelques minutes sur les principales actualités sociales de décembre 2025 et leur impact pour votre entreprise.

Infos clés du mois en droit social – Novembre 2025
Le PLFSS 2026 bouleverse la sécurité sociale : suppression de certains avantages pour les apprentis, durcissement des arrêts maladie, réformes des pensions et création d’un congé de naissance indemnisé. Découvrez notre analyse complète pour comprendre les impacts pour votre entreprise et vos salariés.
