Actus Sociales
– Focus sur 3 jurisprudences du mois de Septembre 2025 –

- Conséquences de la jurisprudence du 10 septembre sur les congés payés
- Retour sur une jurisprudence constante : l’indemnité de fin de contrat versée à l’issue d’un CDD demeure acquise, même en cas de requalification en CDI
- Le saviez-vous ? pas d’indemnités de frais professionnels pour un représentant du personnel qui n’engage aucun frais pendant ses heures de délégation
Conséquences de la jurisprudence du 10 septembre sur les congés payés
Nous l’avons tous compris, par un arrêt du 10 septembre 2025 destiné à la publication au Bulletin des chambres civiles et à son rapport annuel, la Cour de cassation met fin à sa jurisprudence déniant au salarié qui tombe malade au cours de ses congés payés le droit de prendre ultérieurement le congé dont il n’a pas pu bénéficier du fait de son arrêt de travail. Désormais, un salarié en arrêt maladie pendant ses congés a droit à ce qu’ils soient reportés dès lors que l’arrêt est notifié à l’employeur.
Quelles sont les conséquences de la notification d’un arrêt de travail ?
Si l’arrêt maladie a été notifié à la sécurité sociale dans les 48 heures et à l’employeur dans les délais légaux ou conventionnels, se met alors en place l’indemnisation de la période de maladie dont les modalités dépendent des choix de l’employeur (subrogation dans les droits du salarié aux IJSS ou non), de l’ancienneté du salarié et des dispositions conventionnelles.
L’employeur doit alors régulariser la paie, informer le salarié et appliquer, comme le ministère du Travail le préconise, les dispositions du Code du travail relatives au droit au report des congés payés :
- faire un signalement DSN d’arrêt de travail ;
- recalculer l’indemnité de congé payé et, en cas de trop-versé, retenir la part d’indemnités correspondant aux jours de congé payé coïncidant avec la période de maladie ;
- opérer le maintien de salaire, s’il y a lieu, après décompte du délai de carence éventuel ;
- calculer le nombre de jours de congé payé reportés et informer le salarié, dans le mois suivant sa reprise, du nombre de jours de congé dont il dispose et de la date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris (C. trav. art. L 3141-19-3) ; en application des règles de report des congés payés issues de la loi du 22 avril 2024, si la période de prise des congés est en cours, l’employeur pourrait imposer la prise des congés reportés sous réserve de respecter le délai de prévenance d’un mois. Si la période est expirée ou ne permet pas de solder l’intégralité du reliquat de congés payés acquis, le salarié bénéficie d’une période de report de 15 mois débutant à réception de l’information (C. trav. art. L 3141-19-1) ;
- penser à tenir compte de cet arrêt de travail dans le calcul des congés payés de la période d’acquisition en cours puisqu’il donne droit à congés payés à raison de 2 jours ouvrables par mois au lieu de 2,5.
Quelle application rétroactive de cette jurisprudence ?
La solution s’applique rétroactivement aux situations passées sous réserve que le salarié ait notifié à l’employeur les arrêts maladie survenus pendant les congés.
S’agissant de l’action du salarié, il convient de distinguer selon que le contrat est en cours ou rompu. Dans le premier cas, le délai de prescription applicable à l’exercice en nature du droit à congés payés est biennal. Dans le second cas, le délai est triennal, car il s’agit d’une action en paiement du salaire et son point de départ est fixé à l’expiration de la période de prise des congés payés si l’employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement (Cass. soc. 13-11-2023 n° 22-10.529).
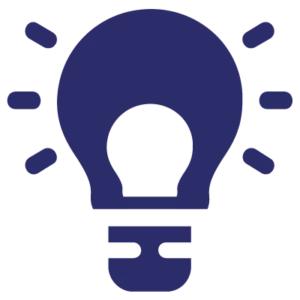 À noter : Désormais, plusieurs questions se posent
À noter : Désormais, plusieurs questions se posent
Par hypothèse, l’employeur qui s’est vu notifier un arrêt de travail avant la décision du 10 septembre 2025 aura le plus souvent appliqué la jurisprudence antérieure : le salarié aura cumulé l’indemnité de congé payé et les IJSS mais l’employeur ne lui aura pas accordé le report de ses congés payés. Le salarié pourra-t-il plaider que l’employeur ne lui a pas permis de prendre les congés reportés auxquels il avait droit et a donc été défaillant ? Dans ce cas, l’employeur ne pourrait pas soulever la prescription de l’action du salarié.
La question se pose également d’identifier les créances réciproques : le salarié malade pendant ses congés aurait dû percevoir, en plus des IJSS, le complément de salaire patronal (non perçu sauf dispositions conventionnelles plus favorables) et non pas l’indemnité de congé payé. Si les congés payés sont reportés, l’employeur devra-t-il indemniser une seconde fois les congés sur le fondement du maintien de salaire ? Ou bien pourra-t-il demander la compensation entre les indemnités versées ou agir en répétition de l’indemnité de congé versée ? Autant de questions que soulève la solution issue de l’arrêt du 10 septembre 2025.
Quel est le point de départ de l’action en répétition de l’indemnité de congés payés intentée par l’employeur ?
Par ailleurs, l’affaire soumise à la chambre sociale de la Cour de cassation lui permet de trancher une autre question inédite, celle du point de départ de la prescription d’une action en répétition de l’indemnité de congé payé versée indûment par l’employeur.
En l’espèce, le litige portait notamment sur des salaires versés à la salariée entre le 1ᵉʳ juin 2013 et le 31 décembre 2016 au titre de congés payés excédentaires dont elle aurait bénéficié indûment. Si la salariée a droit au report des jours de congés payés concernés, c’est donc que sur les jours concernés, elle n’était pas en congés payés, mais en arrêt maladie. En riposte, l’employeur lui a donc réclamé alors le remboursement de l’indemnité de congés payés qui avait été versée au titre des jours concernés.
La Cour de cassation rappelle que cette action, qui a la nature d’une créance salariale, est soumise à la prescription triennale de l’article L 3245-1 du Code du travail. Puis, elle énonce que son point de départ est le jour du paiement de l’indemnité si, à cette date, l’employeur était en mesure de déceler le paiement indu et d’en demander la restitution.
Depuis cet arrêt, l’employeur est en mesure de savoir, à réception de l’arrêt de travail, que l’indemnité de congé payé n’est pas due au titre des jours de maladie.
Dans l’affaire commentée, le contrat de travail étant rompu, la demande de l’employeur portait sur les trois années précédant la rupture du contrat de travail.
Cass. soc. 10 septembre 2025, n° 23-22.732
Retour sur une jurisprudence constante : l’indemnité de fin de contrat versée à l’issue d’un CDD demeure acquise, même en cas de requalification en CDI
Dans un arrêt rendu le 24 septembre 2025, la Cour de cassation s’est prononcée sur le sort de l’indemnité de fin de contrat versée à l’issue d’un contrat à durée déterminée qui n’a pas été poursuivi par un contrat à durée indéterminée. Elle rappelle à cette occasion qu’en cas de requalification ultérieure du CDD en CDI, cette indemnité reste définitivement acquise au salarié.
Rappel de droit sur l’indemnité dite de précarité
Lorsqu’un CDD prend fin à l’échéance prévue, qu’il soit conclu avec un terme précis ou non, et qu’il n’est pas suivi par l’embauche du salarié en CDI, celui-ci bénéficie, en principe, d’une indemnité de fin de contrat – également appelée indemnité de précarité – conformément à l’article L. 1243-8 du Code du travail.
Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles prévoyant un taux plus favorable, cette indemnité correspond à 10 % de la rémunération brute totale perçue pendant la durée du CDD. Sont inclus les primes et accessoires de salaire, à l’exception de l’indemnité compensatrice de congés payés (art. L. 1243-10 du Code du travail).
Cette somme est soumise à l’ensemble des cotisations sociales ainsi qu’à la CSG et à la CRDS, après application d’un abattement d’assiette de 1,75 %, comme le rappelle la circulaire DSS/5B n° 2011-495 du 30 décembre 2011.
Il existe toutefois des exceptions à ce principe, notamment lorsque la nature du contrat (contrat saisonnier, contrat d’usage ou de formation) ou la situation particulière du salarié (par exemple, un jeune embauché durant les vacances scolaires) dispense l’employeur de verser cette indemnité.
Requalification du CDD et indemnité de fin de contrat : le cas d’espèce
Dans cette affaire, un salarié chauffeur-livreur, avait été recruté dans le cadre d’un CDD initial de six mois (du 23 mars au 22 septembre 2021), prolongé par avenant jusqu’au 22 avril 2022. À l’issue de ce contrat, l’indemnité de fin de contrat lui avait été versée avec sa paie d’avril 2022.
Postérieurement, le contrat a été judiciairement requalifié en CDI. L’employeur a été condamné à verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat requalifié, assimilée à un licenciement injustifié.
Pour autant, la cour d’appel avait ordonné au salarié de restituer l’indemnité de précarité perçue, au motif qu’elle n’était plus due dès lors que le contrat avait été requalifié en CDI, et a procédé à une compensation entre cette somme et les condamnations prononcées contre l’employeur.
La position de la Cour de cassation : l’indemnité demeure acquise
La Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle que l’indemnité de précarité vise à compenser la situation d’incertitude dans laquelle se trouve le salarié du fait de l’emploi précaire résultant du recours au CDD (art. L. 1243-8 du Code du travail).
En s’appuyant sur une jurisprudence constante (notamment l’arrêt du 24 juin 2003, n° 00-42.766), elle réaffirme que l’indemnité, dès lors qu’elle a été effectivement versée à l’échéance du CDD, reste acquise au salarié, même en cas de requalification du contrat en CDI postérieurement.
En conséquence, la cour d’appel, qui avait constaté que le salarié avait perçu ladite indemnité à la fin de son CDD, aurait dû en déduire qu’elle ne pouvait être remise en cause, ni faire l’objet d’un remboursement.
Dans un souci de bonne administration de la justice, la Cour de cassation statue au fond et rejette la demande de l’employeur tendant à la restitution de l’indemnité de précarité.
Cass. soc. 24 septembre 2025, n° 24-15.812
Le saviez-vous ? pas d’indemnités de frais professionnels pour un représentant du personnel qui n’engage aucun frais pendant ses heures de délégation.
Le caractère forfaitaire de l’indemnité représentative de frais – et l’absence d’obligation de fournir des justificatifs – ne suffisent pas à requalifier cette somme en élément de rémunération. Le représentant du personnel ne peut prétendre au remboursement de frais professionnels qu’il n’a pas effectivement engagés. C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans un récent arrêt du 1ᵉʳ octobre 2025.
Remboursement de frais et heures de délégation des représentants du personnel : rappels
Conformément à la jurisprudence constante, l’exercice d’un mandat de représentation ne doit entraîner aucune perte de rémunération pour le salarié concerné (Cass. soc., 3 mars 2010, n° 08-44.859). Les heures de délégation sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées à ce titre (C. trav., art. L. 2315-10 ; Cass. soc., 26 juin 2001, n° 98-46.387).
Cependant, lorsqu’aucun frais professionnel n’est exposé pendant ces heures, aucun remboursement n’est dû (Cass. soc., 9 juin 1988, n° 85-43.379 ; Cass. soc., 3 février 2016, n° 14-18.777). Cette règle s’applique même aux indemnités forfaitaires (Cass. soc., 1ᵉʳ juin 2016, n° 15-15.202).
Toutefois, si la somme versée est destinée à compenser une sujétion particulière (par exemple : travail de nuit, déplacements, conditions de travail spécifiques), elle est alors assimilée à un complément de salaire, et doit être maintenue pendant les heures de délégation (Cass. soc., 19 septembre 2018, n° 17-11.638).
En pratique, la distinction entre remboursement de frais et indemnité de sujétion peut s’avérer délicate.
La Cour de cassation tranche : pas de frais engagés, pas d’indemnité
Dans cette affaire, la cour d’appel s’était fondée sur le fait que l’indemnité de collation, bien que qualifiée de remboursement de frais, était versée de manière forfaitaire pour chaque jour de travail effectif, sans exigence de justificatif. Elle en avait donc déduit qu’elle présentait les caractéristiques d’un complément de salaire.
L’employeur, de son côté, soutenait que cette indemnité, même forfaitaire, conservait la nature d’un remboursement de frais professionnels. Selon lui, la finalité de l’indemnité était de couvrir les dépenses de nourriture des agents de distribution postale, contraintes à prendre une collation avant leur tournée.
S’appuyant sur sa jurisprudence antérieure (Cass. soc., 28 juin 2018, n° 17-11.714), la Cour de cassation précise qu’une indemnité – telle qu’une prime de panier – destinée à compenser un surcoût lié aux repas en raison de l’organisation du travail (horaires atypiques, travail posté, etc.) reste un remboursement de frais, même si elle est forfaitaire et versée sans justificatif.
Cass. soc. 1ᵉʳ octobre 2025, n° 24-14.997
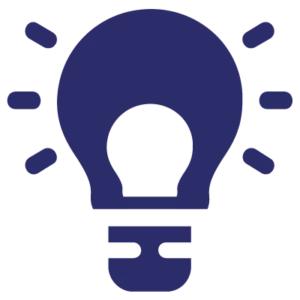 À noter
À noter
Chez ONELAW, nous aidons les employeurs à garder une longueur d’avance. Face à une jurisprudence en constante évolution, notre mission est claire : vous apporter des solutions concrètes, sécuriser vos décisions RH et anticiper les risques. Conseil stratégique, accompagnement opérationnel, défense en cas de contentieux : nos avocats sont à votre disposition pour défendre vos intérêts et faire du droit du travail un levier de performance.
Pour toute question, notre équipe reste à votre disposition.
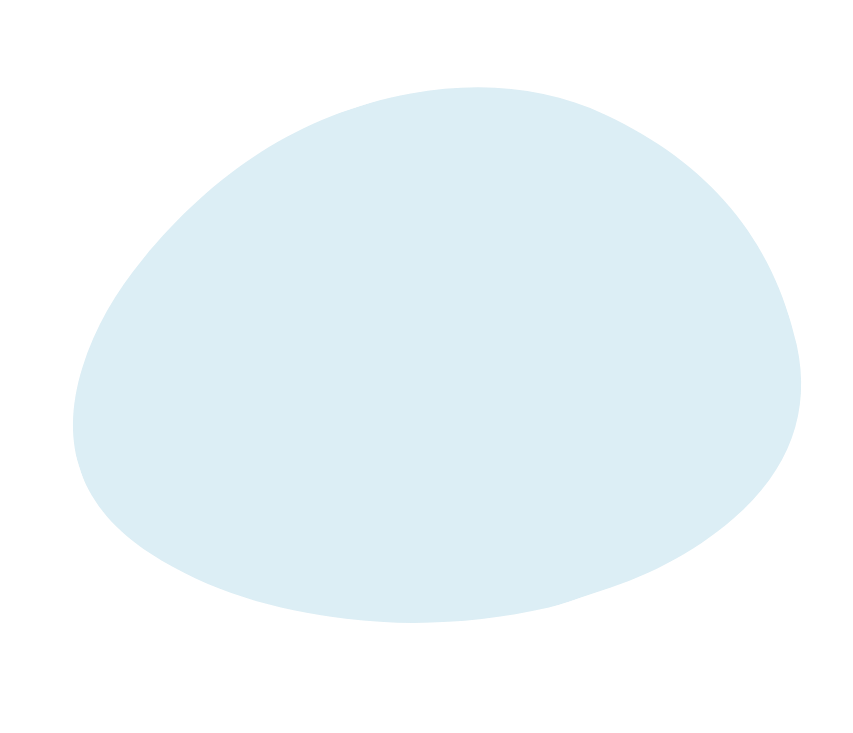
En découvrir plus avec nos articles similaires :

Actualités sociales – Décembre 2025
Plafond de la sécurité sociale, hausse du SMIC, nouvelles règles de contrôle Urssaf, négociation sur l’emploi des seniors et décision récente en matière de maladie professionnelle : faites le point en quelques minutes sur les principales actualités sociales de décembre 2025 et leur impact pour votre entreprise.

Infos clés du mois en droit social – Novembre 2025
Le PLFSS 2026 bouleverse la sécurité sociale : suppression de certains avantages pour les apprentis, durcissement des arrêts maladie, réformes des pensions et création d’un congé de naissance indemnisé. Découvrez notre analyse complète pour comprendre les impacts pour votre entreprise et vos salariés.
